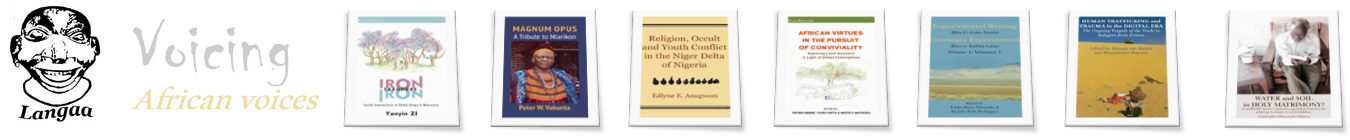Par Divine Fuh traduit par Marie Ndiaye
En 2003, alors que je n’étais qu’étudiant en master à l’Université du Botswana, j’ai eu le rare privilège de participer, en tant que lauréat, à l’Institut sur l’enfance et la jeunesse du CODESRIA, à Dakar, au Sénégal. À l’instar de nombreuses activités intellectuelles et pédagogiques du Conseil de l’époque, ce fut une expérience exceptionnelle et unique. Pour moi, comme pour beaucoup de participants à cet Institut, il constituait nos premières rencontres de niveau international et panafricain. En fait, c’était mon premier véritable atelier ou conférence. Alors que nous échangions avec des pairs venus de différentes parties du continent et du monde, et que nous nous immergions dans des conversations intellectuelles profondes et de très haut niveau, c’est le professionnalisme et le dévouement de tout le personnel du CODESRIA qui, véritablement, se distinguaient. Au cours de mes études doctorales à l’Université de Bâle, j’ai, par intermittence, visité Dakar pour boire à la gourde intellectuelle de Francis Nyamnjoh, Jean-Bernard Ouédraogo, Ebrima Sall, entre autres éminents intellectuels régulièrement et inlassablement appelés à Dakar. Au cours de ces visites, j’ai profité de chaque occasion pour visiter les bureaux du CODESRIA sur l’avenue Cheikh Anta Diop, et ces rencontres et mes conversations avec le personnel du CODESRIA m’ont fait une impression durable. Le soin et le respect avec lesquels ils ont traité ceux d’entre nous dont ils voyaient le potentiel et qu’ils nourrissaient en tant qu’outils du futur projet de savoir de l’Afrique étaient exceptionnellement admirables. Les portes du CODESRIA étaient toujours ouvertes et le personnel, même lorsqu’il était visiblement occupé, était toujours prêt et disponible à écouter, à échanger et à aider, bien que submergé par ce que l’on pourrait appeler le fardeau de l’homme noir, c’est-à-dire la responsabilité de décoloniser, promouvoir et valoriser les savoirs africains, comme l’infrastructure et des chercheurs qui les produisent.
En 2017, je suis retourné au CODESRIA en tant que directeur du Programme publications et dissémination, et j’ai rejoint un groupe de collègues chargé de contribuer à la production panafricaine de connaissances. Quand j’ai déambulé pour la première fois dans ses couloirs, mon ami et frère Ato m’a accueilli avec une plaisanterie profonde : «Massa, nous avons appris que tu es le nouveau Jésus qui nous sauvera de nos péchés de publication. J’espère que tu as amené tes saints pieds pour marcher sur l’eau ». Un an plus tard, Ato a contemplé l’idée d’organiser une conférence sur les «Miracles» comme pour se moquer de nos tentatives de résorber le retard de plus de mille manuscrits dont nous avions hérité. Ce projet portait cependant sur un continent survivant de miracles, investi de miracles, mais qui, également, a besoin de miracles pour faire face à l’immensité de ses défis. Une série de crises mondiales aggrave les malheurs du continent, et leurs ramifications pour la production de connaissances sont sérieuses, en particulier celles mises en évidence par les mesures d’austérité, les coupes budgétaires et le retrait de financement aux infrastructures de production de connaissances. Le terme «Miracles» était le meilleur pour décrire les besoins et la situation du continent. Mon épouse, lorsqu’elle voulait rire de l’énergie que nous avions investie, celle que nous investissions et que nous devions encore investir dans l’énorme défi que nous avions de sauver l’infrastructure et l’écosystème de connaissances du continent, disait : «si vous écriviez cette histoire comme une œuvre de fiction, personne ne croirait à une telle hyperbole». L’histoire institutionnelle des efforts de production de savoir en Afrique a rarement été écrite, ce qui empêche de comprendre et d’être transparent sur la manière dont ces «miracles» surviennent.
D’une certaine manière, le vieux Ansoumana Badji était ce miracle, un homme adoré des miracles, qui priait constamment que nous soyons bénis par les miracles de Dieu. Il disait avoir tout vu. Dans nos conversations, il m’a dit qu’il avait rejoint le CODESRIA très jeune, en 1981 et qu’il avait consacré toute sa vie à la mission et à l’existence de l’organisation, traversant ses hauts et ses bas, assumant différents rôles, avec une forte conviction que l’institution continuerait de grandir et se renforcer. Dans certains des récits de l’histoire de l’institution qui lui ont valu le titre de «professeur» (par ses grandes connaissances de l’institution), le vieux Badji a raconté les discussions entre Thandika Mkandawire et le personnel, dans la salle du courrier, sur la manière de faire collectivement face à l’imminent retrait de finacement dû à la crise financière mondiale des années 1980 ; ou lorsque les collègues ont entrepris Achille Mbembe sur l’amélioration du bien-être du personnel local ; qu’il a reçu des nouvelles de nouveaux financements quand Adebayo Olukoshi est revenu d’un voyage en Europe ; ou qu’il discutait avec Ebrima Sall pour préserver ce qu’il restait des avantages du personnel. Il était, comme il se décrivait lui-même : un syndicaliste, un activiste social et un véritable combattant pour le « personnel local » et le bien de l’organisation, ainsi que le père de nombreux membres du personnel qui l’appelaient affectueusement « Papa Badji » ou « Tonton Badji » et qu’il présentait, fréquemment et avec fierté, comme ses filles, fils, frères et sœurs, « épouses » et parents.
Au cours de l’année qui a précédé l’Assemblée générale du CODESRIA de 2018, j’ai commencé la réalisation d’une série d’enregistrements vidéo documentant les expériences du personnel en matière d’organisation d’assemblées générales, et l’importance de cet événement pour eux. Avec le vieux Badji, il a fallu un certain temps pour le faire parler de l’Assemblée générale car tout ce dont il voulait discuter c’était l’histoire de sa vie dans l’organisation, ses expériences en tant que membre du personnel local et les frustrations de sa vie en tant que « technicien du surface ». Il voulait être entendu et avoir la possibilité de discuter, de manière critique, de la connaissance de l’institution qu’il avait accumulée et de ses opinions sur le dynamisme de la situation. Dans la postcolonie, les auxiliaires tels que les agents d’entretien ou les coursiers (principalement appelés « planton » en Afrique francophone et « messenger » en Afrique anglophone) jouent un rôle absolument important dans la vie de chaque bureau ou organisation : l’achat de pain, de crédit téléphonique, de collations, la collecte-livraison du courrier, la transmission de messages verbaux et de nombreuses autres nécessités quotidiennes. C’est par la totalité de cette expérience, son temps au sein du syndicat du personnel, son âge, son engagement et son dévouement au CODESRIA, et en particulier son amour des débats et de la conversation intellectuelle, qu’il a gagné le nom-titre de professeur, de doyen, ou plus simplement, le Doyen, comme je l’appelais affectueusement.
Le matin quand j’arrivais au travail, comme tous les autres membres du personnel, effectuant la routine matinale de salutations et de taquineries entre parents à plaisanterie, je rencontrais souvent le vieux Badji dans les couloirs près de la salle de conférence, devant le bureau de Ndoffène où nous faisions des blagues subversives, et l’écoutions raconter, en riant, des histoires. Comme tout le monde, il portait jalousement sa baguette à la main et parfois sous le bras, pour participer au ndéki, le rituel convivial du petit-déjeuner qui était le prétexte de nombreuses histoires et conversations. Dans le couloir, il plaisantait sur les Sérères et les Diola, racontant des mythes et des histoires populaires sur les Sérères retournant dans leurs villages avec de gros sacs de pain en haut des bus rafistolés qui, régulièrement, transportent des passagers entre Dakar et les autres régions. Parfois, le chef du protocole, Marième Ly, avec qui il avait développé une relation ludique à la Tom et Jerry autour du ndéki se joignait à nous quand elle entrait dans le bâtiment du CODESRIA. Parfois, au ndéki, il faisait semblant de se cacher de Marième, qui après l’avoir rattrapé, lui prenait en plaisantant sa tasse de thé et redistribuait son pain aux plus jeunes «techniciens». Ce jeu du chat et de la souris était hilarant et symbolique de la profonde amitié, la confiance et le lien qu’il a tissé avec le personnel au fil des ans. En tant que Doyen et vénérable professeur, il avait toujours une histoire et quelque chose à dire sur tout, et insistait souvent sur le fait qu’à son âge, il n’avait peur de rien ni de personne, car il se concentrait sur le bien-être de l’organisation. Son vœu était que le CODESRIA devienne fort, qu’il devienne riche et que les nouvelles générations la nourrissent avec dévouement et continuent de faire respecter ses traditions et ses principes. Et en vrai doyen, le vieux Badji pensait que les jeunes étaient soit trop rebelles, soit trop radicaux, ou qu’ils n’avaient aucun respect pour les traditions, et donc risquaient de détruire ce qu’ils n’avaient pas construit.
Lors des entretiens de 2018, quand je lui ai demandé de parler de son expérience de l’Assemblée générale et de sa signification pour lui, Badji a déclaré: «Le CODESRIA est tout pour moi. Le CODESRIA, c’est un livre entier. Je ne sais pas par où commencer. Le CODESRIA représente tout pour moi. Le CODESRIA m’a tout donné. Quand je suis arrivé ici, j’étais un jeune homme. Aujourd’hui, je travaille au CODESRIA depuis 37 ans. Je suis venu célibataire, je me suis marié, j’ai eu mes enfants, [et] j’ai un fils qui travaille maintenant. Le CODESRIA m’a tout donné! » C’est probablement ce qui a motivé sa profonde loyauté, son droit à et son appropriation de l’organisation, du moins pendant le temps que j’y étais. Il a insisté sur le fait que chaque cadre supérieur et nouveau «patron» devait faire preuve d’humilité et apprendre de lui et du personnel, qui, selon lui, a érigé l’organisation pièce par pièce. Je l’ai souvent révéré, lui et d’autres tels que les compositeurs Daouda Thiam et Sériane Camara Ajavon, le magasinier Edgar Diatta, les bibliothécaires Abou Ndongo, Jean-Pierre Diouf et Emiliane Faye, le comptable Amadou Diop, la responsable des membres, Marie-Ndiaye et le vigile ou «gardien», Pape Abdoulaye Fall comme les archives vivantes et les symboles de la ténacité, de la résilience et de l’optimisme du projet de connaissances de l’après-indépendance. Dans l’esprit du vieux Badji, l’histoire de l’organisation telle qu’elle a été conservée, mandat après mandat de chaque secrétaire exécutif, était fermement implantée. Il se souvenait vivement de chacun et les évaluait, surtout par leurs prouesses intellectuelles, leur engagement pour les préoccupations du personnel, leur vision de l’institution, la collecte de fonds, et surtout par leur capacité à faire preuve d’humilité et à se joindre au personnel d’entretien et d’autres, pour le thé, en bas, dans la salle du courrier et l’imprimerie, qui n’existent plus aujourd’hui. Pour chacun, il avait développé un profil, une théorie et une prière. Mais toujours, il insistait qu’il faut prier, comme le ferait un Doyen. Il avait tout vu. Et qui a besoin d’un marabout quand on a Badji ?
Le professeur-doyen Badji me rappelait souvent les personnages que j’avais rencontrés dans les romans de l’écrivain camerounais, Ferdinand Oyono, Vie de boy (Toundi) et Le vieil homme et la médaille (Meka). Dans un hommage à Oyono, Shola Adenekan observe: «Son deuxième roman, Le vieil homme et la médaille (1956), évoque le profond sentiment de désillusion ressenti par ces Africains engagés avec l’Occident, mais rejetés par leurs maîtres coloniaux. »
Dans ces romans, l’humilité, le franc-parler, la ténacité, la loyauté sans réserve, la curiosité, un mélange de facteurs politico-culturels et le désir de consommer et de participer à la modernité ont, permanamment, précarisé et mis en suspens les nœuds aspirationnels, altérant ainsi radicalement la valeur et les modalités de reconnaissance des personnages. Pendant plus de trente-sept ans, le professeur-Doyen Badji est resté fidèle à sa profession et à sa vocation de préposé aux pauses café, après avoir obtenu son diplôme de « technicien de surface » à la suite de ce qu’il a souvent qualifié de situation malheureuse, une maladie affectant ses capacités sensori-motrices et son corps. Mais cela lui a également offert l’opportunité d’encadrer un nouveau groupe de jeunes «techniciens», qu’il appelait gosses, comme le ferait n’importe quel gorgui (vieux) de sa stature. J’étais un gosse, juste un gamin, et c’était mon père. Car il faut une forme de narcissisme habile, un manque de respect et un mépris total pour les coutumes africaines pour ne pas être intimidé par de tels anciens quand ils sont vos subordonnés, surtout quand ils sont si accomplis, si pleins de sagesse et qu’ils maîtrisent une telle connaissance-histoire institutionnelle, profonde et inestimable. C’est également ce qui a amené des collègues comme Ato Onoma, Parfait Akana et Mamadou Dramé à appeler respectueusement Tonton Badji, professeur, Goro (beau-père), ou le «gourou».
Le professeur-Doyen Badji a commencé à travailler au CODESRIA alors que je n’étais même pas à l’école primaire, et depuis ma première rencontre avec lui à l’Institut sur l’enfance et la jeunesse du CODESRIA en 2003, j’ai obtenu un doctorat, travaillé comme universitaire à l’Université du Cap en Afrique du Sud, puis je l’ai retrouvé au siège du CODESRIA à Dakar 14 ans plus tard en tant que membre du Secrétariat. Doyen Badji en savait beaucoup sur les énormes défis de mon programme, partageant parfois ses opinions et discutant souvent de ceux qui, avant moi, avaient essayé, mais qu’il a surtout observés avec une distance bien informée. Il connaissait le script, et pour lui, je n’étais probablement qu’un autre personnage de la pièce. Quand j’étais directeur par intérim de l’administration et des finances, puis du CODICE, Badji, malgré mon jeune âge et mon peu d’expérience dans l’organisation, me parlait régulièrement en tant que «patron»; il ne manquait jamais une occasion de s’exprimer ouvertement. Comme il le disait toujours, je dis ce que je pense, je te dis la vérité, tu n’aimeras pas ça, mais je ne le ferai pas dans ton dos. Il s’est engagé à améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux du personnel et a profité de chaque occasion pour être franc à ce sujet. Je me suis souvent demandé ce que ce serait si les biographies intellectuelles de professeurs comme Doyen Badji étaient privilégiées, mais aussi ce que cela signifierait de nourrir et d’incorporer ou d’intégrer des intellectuels comme lui dans le travail intellectuel que nous organisions. Pour que cela se produise, il faut un changement, une inversion ou une expansion de ce qui est archivé et normalisé en tant que forme matérielle de connaissance, et des indicateurs de réussite personnelle.
Quand il ne servait pas le thé, le petit bureau à la porte, le manguier dans la cour, la salle de conférence, le magasin, la cour et l’atelier du menuisier-artiste à côté du CODESRIA étaient son bureau et certains de ses lieux de rencontre préférés, et où il a, de manière si articulée, débattu du monde; tandis que son regard ethnographique observait et analysait attentivement les subtilités, et les tenants et aboutissants de la première organisation de recherche panafricaine d’Afrique. Il y a eu des moments où je l’ai croisé en train de se changer dans la cabine des interprètes qu’il utilisait comme vestiaire, et dans la salle de conférence où il faisait parfois une petite sieste, entouré de l’esprit de nombreux intellectuels nourris dans cette salle, et loin du fardeau des années à voir, à connaître et à contempler. Au bout de trente-huit ans de son existence engagé dans l’organisation, il n’avait pas d’espace dans l’immeuble qu’il pouvait appeler son bureau ; le ciel était son toit et la terre son plancher, raison aussi pour laquelle il était souvent itinérant. Comme les vieux restaurateurs, au cours de la journée, il nettoyait soigneusement les outils de son métier de préposé aux pauses café : chaque tasse, cuillère à café, soucoupe, verre, etc. J’ai toujours été fasciné par la manière systématique avec laquelle il essuyait et combattait méticuleusement la poussière dans un endroit où il faisait, en permanence, partie du décor. L’uniforme brun kaki, unforme de travail des «techniciens», le projetait davantage comme un artisan. Je l’ai souvent considéré et admiré comme un fin artisan, méritant donc les titres de Doyen et de professeur. En l’observant, j’ai tranquillement appris et me suis inspiré de la méticulosité, de la ténacité, de la résilience et de l’entêtement nécessaires pour, sans état d’âme, émanciper les connaissances africaines, en particulier dans un monde dans lequel, comme le fait éloquemment valoir Francis Nyamnjoh, nous sommes passés de publier ou périr à publier et périr. C’étaient aussi des leçons sur l’inclusion et la valorisation de chaque acteur et chaque contribution, en particulier ceux qui sont si présents mais toujours absents parce qu’ils ne peuvent être comptés et sont donc considérés comme insignifiants.
Dans l’écosystème mondial de production de connaissances dont nous avons hérité et que nous continuons de célébrer, l’importance portée aux extrants, au nombre de publications, aux facteurs d’impact et aux index de citations, entre autres, signifient qu’il existe une hiérarchie dans laquelle certains acteurs sont privilégiés, valorisés et visibles, tandis que d’autres ne sont jamais ou presque jamais reconnus. Le travail inestimable qui va dans ce que j’appelle «le back-office» est absolument essentiel pour toute production réussie, car sans lui, rien ne se passe. La période de 1981, date à laquelle il a commencé à travailler au CODESRIA, à 2019, date à laquelle le vieux Badji a pris sa retraite, raconte comment réinventer le projet panafricain de connaissances décoloniales de manière à dé-bureaucratiser et dé-hiérarchiser les relations. Dans notre quête de théorie alternative et authentiquement africaine de la connaissance, nous devons veiller à ne pas dévaloriser, aliéner et frustrer ce qui fonctionne, comme le prolétariat ou la classe ouvrière de l’entreprise du savoir. Alors que les archives brûlent et disparaissent dans diverses parties du continent, nous n’avons d’autre choix que de veiller, lors de la reconstruction, que chaque histoire ordinaire soit incluse, racontée et prise en compte. Tout compte et tout ce qui compte doit être compté. Alors que les visions et les métaphores de et pour la décolonisation du savoir sont légion et se diffusent de plus en plus, la violence perpétuée par des décennies de destruction des infrastructures du savoir nécessite des miracles pour s’en émanciper.
Lors de l’entretien en 2018, le vieux, le professeur Badji, le Doyen, était inquiet, malgré nos assurances que de nouvelles pratiques de collégialité, de production de connaissances et de développement des infrastructures créaient des divisions toxiques dans le projet de savoir panafricain et parmi ses fantassins, lui insistait sur son fusionnement et son fonctionnement comme un collectif unifié. Les nouveaux développements modernes et le managérialisme néolibéral avaient rapidement redéfini son travail et le rôle de préposé aux pauses-café, le rendant superflu et faisant de lui un invité-spectateur dans son lieu de travail, son travail étant sous-traité à des entrepreneurs privés externes. En fait, à plusieurs reprises, il était présent mais a dû regarder les pauses-café dont il était en charge être servies depuis la tente qui faisait office de stand dans la cour, et auxquelles il ne pouvait pas participer. Comme Toundi, le domestique d’Oyono, il savait et avait tellement vu que, même si c’était le résultat d’une vue de plus en plus défaillante, il commença à se parer de lunettes de soleil sombres comme pour échapper et se protéger des gens, des ragots et rumeurs, du commandement et de ses problèmes, ou mieux encore, mettre en avant son éminence de sage et de Don accompli.
En 2018, dans mon entretien avec lui, il a souligné: «Le CODESRIA est pour tout le monde. Tout le monde doit s’y laver les mains. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit y ajouter son grain de sel. Si le CODESRIA gagne, c’est tout le monde qui gagne. Si le CODESRIA perd, tout le monde perd. Ne mettez personne sur la touche». Lors de l’Assemblée générale du CODESRIA de 2018, le Secrétaire exécutif, Godwin Murunga, a organisé une session spéciale pour distinguer et honorer le personnel partant à la retraite qui avait consacré sa vie et son existence au service de l’organisation. A la fin d’une journée au milieu de l’assemblée, chacun a reçu une plaque et tous ont eu le rare privilège d’une séance photo avec l’ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui était un des conférenciers à l’événement, et idolâtré par beaucoup. Au moment de la surprise, il s’est malheureusement trouvé, que le gourou, le Doyen, le professeur Badji s’était embarqué pour son habituel trajet de près de 30 à 40 kilomètres en transport commun jusqu’à son domicile dans la Zone de Keur Massar à l’extérieur de Dakar, pour ne pas être pris au piège du crépuscule et donc se préparer à revenir au travail à l’aube. Cela lui a fait manquer la cérémonie de distinction et la séance photo avec le poète et homme d’État, MonsieurI am an African, lui-même, ce que plusieurs membres du personnel allant à la retraite, comme Amadou Diop, considéraient comme l’une des heures de gloire de leur illustre carrière au service de l’organisation et du continent africain. Gorgui Badji a tout manqué, en particulier la séance photo avec le président Mbeki qu’il avait tant espérée et tant désirée. Presque comme le Meka d’Oyono, la célébration de la plaque, la longue attente de la de reconnaissance et le désir d’un moment figé avec l’ancien président Mbeki se sont dissipés dans la nécessité de rentrer chez lui. Mais Gorgui Badji n’est pas Meka et le contexte n’est pas exactement le même.
Peu de temps après avoir pris sa retraite du CODESRIA, le personnel lui a organisé une fête de départ en février 2020. Quatre mois plus tard, le 26 juin 2020, le Gourou, Doyen-Professeur Ansoumana Badji est décédé, la même année que Thandika Mkandawire, Manu Dibango et tant d’autres s’en sont allés. Pendant trente-huit ans, il a consacré sa vie à l’organisation, qui lui a tout donné et qui était tout pour lui. Comme la figure marginale imposante qu’il était, sa mort a eu lieu tranquillement au milieu de la pandémie de covid-19, passant presque inaperçue du grand nombre de chercheurs, d’universitaires et d’intellectuels dont il a contribué à la carrière et à la vie, et qui ont bu le thé cosmique qu’il leur a servi avec passion. Pas de numéro spécial de revue, pas de festschrift posthume, pas de tableaux d’hommage dédiés, pas de services commémoratifs mondiaux, pas de célébration. Mais comment célébrer une figure aussi imposante ? Aurait-il aimé une célébration ? Comment peut-il être commémoré ? Comment conservons-nous des archives si pertinentes mais greffées dans les pochoirs de nombreux cerveaux gérontocratiques ? Et comment valoriser ces bibliothèques dans un monde où le texte et sa numérisation sont des éléments centraux de la création de valeur ? De lui, nous pouvons tirer de nombreux enseignements, en particulier dans la lutte décoloniale pour l’émancipation des savoirs africains.
Pour introvertir et répondre à la critique de Paulin Hountondji à l’égard de l’extraversion de la production scientifique africaine, nous devons mutualiser, fusionner, connecter et adopter une nouvelle politique inclusive et une nouvelle pratique de solidarité. Les enjeux de la production et de la décolonisation du savoir panafricain sont si élevés que nous ne pouvons nous permettre l’aliénation, le cloisonnement et la réduction d’acteurs et de contributions que nous consirérons comme insignifiants. Des décennies d’extraversion exigent que les pratiques compétitives et dénigrantes qui ont freiné et divisé les solidarités soient remplacées par de nouvelles interventions collectives et un activisme du savoir qui traitent tout le monde et toutes les contributions comme étant également valables. Dans un monde où nous luttons pour l’audibilité et la lisibilité, notre première stratégie est de faire en sorte que toutes les histoires sur lesquelles nous pouvons mettre la main soient racontées et valorisées afin, à la fois, de dominer et de diriger le récit. Une fois qu’une partie importante de ces archives sera créée, nous pourrons commencer le processus d’élargissement et de création d’alternatives aux systèmes actuels d’évaluation, de valeur, de reconnaissance et de récompense qui dominent la production scientifique.
Comme les chercheurs postcoloniaux, décoloniaux et de la décolonisation (Nyamnjoh, Mignolo, Mbembe, Oyeronke, Dabashi) continuent de le souligner, un projet d’émancipation des connaissances devrait avoir pour objet d’inclure et de s’ouvrir plutôt que de restreindre, de provincialiser et d’exclure. Dans l’écosystème de production de connaissances, chaque acteur et chaque contribution compte – chauffeurs, agents d’entretien, rédacteurs, éditeurs, distributeurs, traducteurs, coursiers, libraires, etc. Une petite fenêtre d’opportunité s’offre à nous. À mesure que progressent les discussions et les négociations sur les conditions d’engagement autour de la zone de libre-échange africaine, il est essentiel que les militants panafricains du savoir, sur le continent et dans le caucus mondial, mutualisent leurs efforts et se mobilisent pour garantir une circulation des connaissances à travers les frontières nationales et régionales qui est essentielle pour toute nouvelle organisation économique. Il est crucial que le travail de petites mains dévouées et de camarades comme le Gourou, le vieux Doyen-Professeur Badji ne soit pas vain. En perturbant les hiérarchies, en faisant progresser la praxis inclusive et en adoptant de nouvelles politiques de solidarité comme Tonton Badji l’a souligné dans ses conversations, nous pouvons progressivement commencer à nous déplacer vers ce lieu où chacun dans le système n’est pas seulement valorisé mais peut également consommer ce qu’il participe activement à produire, et aussi rêver au-delà des limites de la surface technique dans laquelle ils sont circonscrits.
Permettez-moi de terminer cet hommage avec une anecdote de mes premiers jours de travail au CODESRIA en 2017. Plein d’énergie, d’idées et de passion dans ma tentative de faire des «miracles», je prenais parfois le balai pour nettoyer mon bureau et réarranger les livres sur mon étagère, et un jour fatidique, j’ai pris le seau et le balai pour nettoyer le sol que j’avais sali en déplaçant des papiers. Ce fut la dernière fois que je fis une telle bévue. Le vieux Tonton Daouda s’est précipité vers moi et a tenu mes mains, me demandant de bien vouloir lâcher le balai, le seau et la vadrouille, tout en appelant l’un des «techniciens» pour qu’il vienne nettoyer. J’ai protesté et insisté qu’il me laisse faire; je le faisais à la maison et je voulais être impliqué dans les travaux de nettoyage. C’était ma propre façon d’honorer les «techniciens» en allégeant la charge de leur travail. Le vieux m’a pris par la main et m’a guidé vers mon bureau. Là, m’a parlé doucement comme il le faisait toujours: «Divine, il y a une chose pour chacun. Je sais que tu peux le faire, mais tu dois permettre à d’autres personnes d’exister. Lorsque tu fais cela, que penses-tu qu’ils devraient faire? Que veux-tu qu’ils fassent de leur travail? » Nos rencontres avec la modernité néolibérale nous rendent parfois insensibles, imprudents et émotionnellement inintelligents dans nos pérégrinations dans le monde, à travers des cadres de référence universels. Des sages comme Tonton Badji ont insisté sur le fait que tout le monde comptait et que chacun, dans ces petits ou grands endroits, contribuait à l’image holistique. Dans l’écosystème du savoir, chacun de nous détient une pièce du puzzle, et est donc tout aussi valable, sinon le résultat obtenu est l’incomplétude.
Le plus grand défi que nous ayons eu et que nous continuons de subir en tant que communauté du savoir est l’incapacité d’être libre avec nos idées, d’être qui et ce que nous sommes et pouvons être, et de ne pouvoir laisser le stylo courir et sourire dans notre mains comme c’est le cas pour de nombreux autres dominants. Mais nous ne pouvons pas résoudre cette violence par l’exclusion, la dévaluation et l’aliénation. Pour reprendre une phrase du professeur-Doyen, la production de connaissances est pour tout le monde, et personne ne doit être mis à l’écart. Au cours de l’année écoulée depuis qu’il a quitté notre royaume, j’ai beaucoup réfléchi à ce que j’écrirais comme épitaphe sur sa pierre tombale si on me donnait l’occasion de le faire : «Voici le miracle-Gourou-Doyen-Professeur Ansoumana Badji qui a donné toute sa vie au CODESRIA et pour qui le CODESRIA était tout ».
Lorsque Langaa RPCIG a publié cet hommage pour la première fois, le samedi 15 mai 2021, j’ai reçu de nombreux commentaires, réponses et effusions de collègues du CODESRIA, d’anciens lauréats et de personnes qui ont rencontré le professeur Badji, que, je pense qu’il est important d’inclure ici. Williams Nwagwu, qui était responsable de programme et du CODICE, a fait remarquer que c’était «beau [et un] bon moyen de célébrer Badji», mais il voulait savoir «pourquoi autorisé?» Dans l’institutionnalisation bureaucratique, tout nécessite une procédure, une approbation et une autorisation. Étant donné que je n’ai ni demandé ni obtenu l’approbation ou l’autorisation d’écrire, de publier et de diffuser cet hommage, comme il devrait l’être, la mention « non autorisée » est un gage de transparence. Dans sa réponse, Francisco Sozihno, ancien Secrétaire exécutif adjoint, a déclaré: «J’espère que Badji verra l’hommage.» Tiny Diswai, ancienne directrice de l’administration et des finances l’a qualifié de «réconfortant», notant «Oh, Badji. Tu te reposes. Tu as toujours été si positif et si plein de vie. Toujours accueillant et souriant ». Le magasinier, Babacar Anne, l’un de ceux que les Doyen a formé et aidé à passer de «technicien» à magasinier a écrit: «Badji mon grand frère, il a passé la majeure partie de son existence au service du CODESRIA.» Diama Bèye, qui a été mon assistante au Programme publications et dissémination et actuellement assistante à la librairie du CODESRIA, a déclaré: «Papa Badji était mon père. Il a conseillé à tout le monde ». Mon ancien collègue Samuel Osime, qui était éditeur en chef des publications en anglais, a fait la remarque suivante: « Il y a une chanson: ‘… on se souvient de nous par nos actions’. La meilleure façon de laisser une trace indélébile dans le sable du temps est de rendre un service constant, engagé et désintéressé, quels que soient le statut, la stature et le poste. Badji l’a incarné avec brio. Il nous manquera énormément ». Ibrahima Niang, chercheur postdoctoral à HUMA – Institut des sciences humaines en Afrique à l’Université du Cap qui a régulièrement interagi avec le vieux Badji a observé dans ses commentaires que les institutions doivent reconnaître les petites gens qui les servent. «Je l’ai appelé le chercheur qui cherche.» L’ancienne responsable des membres, Marie Ndiaye, qui a travaillé avec le professeur Badji pendant des décennies et au bureau de qui on le trouvait souvent, est très profonde. Elle écrit: «Ansoumana Badji est le dernier des Mohicans. Badji les a tous rencontrés : de Kazadi Nduba wa Dille à Isabel Casimiro. Badji a travaillé avec eux tous, de Samir Amin à Godwin Murunga. Badji a suivi le CODESRIA partout : de l’IDEP à l’avenue Cheikh Anta Diop. Il était là à chaque changement : du Conseil des directeurs au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Il était présent au premier institut CODESRIA, un Institut sur la Gouvernance démocratique, aux côtés des Raufus, des Bayos…. Quand, un jour, l’autre histoire du CODESRIA sera écrite, l’histoire de la vie de tous les jours du CODESRIA, celle que vous ne trouverez pas dans les Bulletins, les rapports ou les catalogues, Badji figurera en bonne place pour son service, son dévouement et son amour du CODESRIA. Badji était un père de famille, un mélomane, un excellent danseur de salsa et un collègue espiègle, drôle et attentionné ». Comme mon ami et ancien éditeur-en-chef des publications en français, et aujourd’hui professeur à l’UCAD, Mamadou Dramé a observé: « Ansoumana était un grand homme. Nous vous tirons notre chapeau, grand gourou, Professeur-Doyen Ansoumana Badji ».
Bio : Divine Fuh est un anthropologue social camerounais et le directeur de HUMA – Institut des sciences humaines en Afrique à l’Université du Cap. Il a été directeur du Programme publications et dissémination du CODESRIA de 2017 à 2020, et lauréat en 2003 de l’Institut du CODESRIA sur l’Enfance et la jeunesse. Divine est rédacteur en chef et fondateur de Langaa RPCIG. Ses recherches portent sur la jeunesse, l’urbanité et la politique de la souffrance et du sourire, l’économie politique de la production et de l’édition du savoir panafricain.
Bio : Marie Ndiaye est retraitée du CODESRIA et une figure familière du Conseil. Elle a pris sa retraite du CODESRIA en février 2019 après près de 30 ans de service au Conseil et à la communauté panafricaine du savoir. Tout au long de sa carrière au Conseil, elle a assumé diverses fonctions et travaillé dans divers départements et programmes du Secrétariat du Conseil, à Dakar. Dans ses dernières années au Secrétariat du CODESRIA, elle a été en charge du Service aux Membres au Bureau du Secrétaire exécutif et du Secrétaire exécutif adjoint. Marie est également éditrice de textes et traductrice travaillant avec le français, l’anglais et le wolof. Elle a effectué des traductions pour le CODESRIA et plusieurs organisations internationales à Dakar, au Sénégal.
Divine Fuh
HUMA – Institute for Humanities in Africa
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Courriel : divine.fuh@uct.ac.za
Marie Ndiaye
Villa 8870 Sacré-Coeur III
Dakar, Sénégal
Courriel : marie.birane@gmail.com