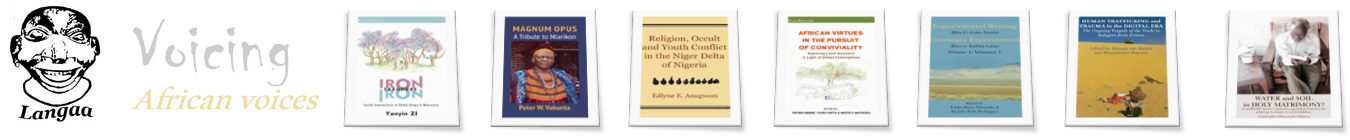Entretien avec Sylvain Thevoz
Que ce soit dans vos ouvrages De la postcolonie ou Sortir de la grande nuit, vous faites une critique radicale de la pensée totalisante qui construit l’Autre selon ses fantasmes et besoins propres. Vous parlez de l’Afrique en termes d’un espace unifié. Comment envisagez-vous cet espace Afrique et quels sont ses dénominateurs communs ainsi que les éventuels espaces qui s’y soustraient ?
En réalité, je parle de l’Afrique en tant qu’assemblage d’espaces constamment produits sur le mode de l’enchevêtrement et de la prolifération, de la disjonction et de la circulation.
Historiquement, deux principes gouvernent la production des espaces africains. Et d’abord la multiplicité. Qu’il s’agisse des formes de vie, des logiques institutionnelles ou des rationalités économiques et culturelles, tout, ici, s’est toujours conjugué au pluriel. Le principe de l’Un nous est pratiquement inconnu. Le polythéisme social et culturel, telle est notre signature.
Il s’en suit que la vie sociale, culturelle et politique est régie par les logiques de la composition (addition des fragments), ou encore des réseaux. D’ailleurs, l’une de nos difficultés sur le temps long provient du fait que la logique des réseaux a souvent pris le pas sur celle des institutions. Nous avons toujours peine à édifier des institutions durables, et je me demande si ce défaut n’est pas en rapport avec l’absence d’écriture, la sorte de discipline qu’impose la double culture de l’écriture et de la comptabilité.
De toutes les façons, la vie elle-même consiste à savoir mettre ensemble des éléments composites, disparates, à la limite incompatibles ; puis a établir des équivalences entre eux ; a transformer les uns en les autres. C’est ce qui explique qu’au fond, les sociétés africaines sont bien plus ouvertes à l’innovation qu’on ne l’a prétendu. Elles portent volontiers le masque de la tradition. Mais il s’agit d’une tradition chaque fois réinventée. S’il y a une loi sociale qui régit la vie en Afrique, c’est donc dans ce type de calcul qu’il faut aller la chercher – dans cette capacité permanente de conversion et de reconversion des choses en tout et en leur contraire.
La deuxième chose qui caractérise ces espaces, c’est la circulation. Il n’y a d’espace ‘africain’ qu’en circulation, en mouvement, itinérant. Il n’ y a qu’à voir la place accordée aux pratiques de la longue distance, aux cultures de la migration, ou aux milles manières de domestication du lointain. Par ailleurs, tout, ici, participe de la logique des flux. D’ou, au fond, une certaine ephemeralite. Rien apparemment ne semble s’inscrire dans la durée. En l’absence d’une conscience vive du futur, l’imprévoyance fait loi. Tout est transitoire, provisoire. Les pratiques de la capture l’emportent sur le travail de production en tant que telle. Partout domine une conception instantanéiste du temps et de la durée.
Vous avez placé le pouvoir au centre de vos ouvrages. Vous avez notamment posé la question des limites du pouvoir de l’État et avancé l’hypothèse de la société civile comme contrepoids a l’Etat. Vous parlez d’une émasculation de l’État et d’une excision de la souveraineté dans la postcolonie. Le pouvoir, désormais, il est où et à qui ?
En réalité, dans mes travaux, je n’utilise presque jamais le terme de société civile pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici. Mes travaux sur le pouvoir portent sur un épisode historique assez particulier, qui va des années 1920 jusqu’au dernier quart du vingtième siècle. On sait que le dernier quart du vingtième siècle africain fut marqué en très grande partie par les politiques de déflation ou encore d’ajustement structurel, les guerres de prédation, l’essoufflement des nationalismes, le réveil religieux et culturel et l’apparition de nouvelles formes de luttes pour la vie.
Le contexte de l’époque était celui de la fragmentation du pouvoir d’État, d’une certaine démonopolisation de la violence et d’une déterritorialisation relative des ensembles hérités de la colonisation. Ces processus ont très fortement marqué la vie du Continent même si leur intensité et leurs effets varient d’un pays à l’autre.
Mais sont venus s’y ajouter, en ce début de siècle, d’autres facteurs de longue durée. Ainsi, par exemple, de l’intensification de l’économie d’extraction, de la montée d’une civilisation urbaine inédite, de la reproduction sur une échelle transnationale des classes au pouvoir depuis la décolonisation, et de l’émergence d’une classe de sans-travail notamment parmi les cadets sociaux, véritable viande humaine prédisposée à la ponction, et pour lesquels la migration représente à la fois un risque mortel et une opportunité. Avec ses terres relativement vierges, ses immenses ressources énergétiques et bio-environnementales, ses innombrables gisements miniers et son marche potentiel de plus d’un milliard d’habitants, l’Afrique représente objectivement la dernière frontière du capitalisme.
Le pouvoir, dans cette constellation, est plus que jamais diffus. Mais davantage encore, il fait l’objet d’une privatisation accrue. Pour ceux qui en sont les détenteurs, il s’agit chaque fois d’en faire une propriété privée. D’autre part, le pouvoir se déploie en noyaux, latéralement, sur un mode transnational, sous la forme de particules, dans l’instabilité et le flottement – d’où en partie sa rapacité et sa brutalité, mais aussi sa faiblesse. Il peut soudain s’écrouler, du jour au lendemain, presque sans préavis, mais sans que sa structure fondamentale – extractive, prédatrice et ordonnée a la consommation – ne soit le moins du monde ébranlé. Le paradoxe, je dirais, est que l’ensemble des facteurs en vue d’une transformation révolutionnaire du Continent sont la. Mais la perspective d’une révolution sociale radicale n’a jamais parue si éloignée qu’aujourd’hui.
Certains pays comme le Rwanda semblent avancer à marche forcée vers un modèle de développement ultra-néolibéral, décrochant au passage le nom de « Singapour africain », au risque de faire sauter des attaches sociales. Quelles conséquences cela a-t-il sur l’individu et ses liens d’appartenance, et sur les rapports de genre ?
Le Rwanda est, à plusieurs égards, un Etat-garnison, une principauté militaire dirigée par une caste d’hommes et de femmes armés. Les origines de cet Etat-garnison se situent dans un meurtre quasi-primordial et presque sacrificiel, le génocide des Tutsis. Ce grotesque évènement réalisée a partir de techniques purement artisanales a pour prolongement direct le contre-génocide dans l’Est du Congo.
Contrairement au génocide des Tutsis, le contre-génocide dans l’Est du Congo est de type moléculaire. Il dure depuis plus d’une décennie. Il a déjà cause plus d’un million de morts. Ces morts (directes et indirectes) sont le résultat de guerres de nature à la fois segmentaire et rhizomatique, au cœur desquelles se trouve chaque fois la question de la propriété du sol et de l’extraction des richesses du sous-sol, sur fonds de militarisation du commerce et de fragmentation des dispositifs de la violence. Les catastrophes et souffrances humaines causées par ce processus au cours des quinze dernières années sont incalculables.
Mais plus que Singapour, l’État rwandais se prend pour l’Israël des Grands Lacs. Il cherche à arrimer sa légitimité dans son propre holocauste et rêve de coloniser l’Est du Congo démocratique tout en évitant, pour l’heure, d’en faire sa bande de Gaza. Tout comme Israël, l’Etat rwandais estime que le génocide des Tutsis lui assure une sorte d’immunité historique par rapport aux crimes qu’il serait amenée a commettre dans le présent et le futur et l’exempte de ses obligations a l’égard du droit international. Ce type d’imagination est, à proprement parler, nécropolitique.
Pour dire et raconter l’Afrique, vous proposez d’inventer une écriture et une langue capables d’aller à la rencontre des esprits des morts, d’affronter la part nocturne de l’histoire africaine, ses spectres. Penser la faille, dans la faille, est-il une des voies possibles de sortie des essentialismes ?
La question de la langue et de l’écriture est essentielle si l’on veut sauver le signe africain d’une longue histoire d’abjection et restituer à l’Afrique sa force et sa puissance propre.
L’Afrique doit, en effet, redevenir son centre propre, sa force propre.
Il ne s’agit pas de retourner à un passé mou et souvent illisible. Il s’agit de composer quelque chose d’éminemment neuf et qui, de par sa puissance à la fois matérielle et de signification, nous permette de nous hisser à hauteur du monde.
Une telle langue et une telle écriture ne sont possibles que si elles se laissent habiter et porter par la force du vivant.
Elles doivent, pour ce faire, explorer non des essences immuables et toutes faites, mais les failles et les interstices, les différents lieux d’ou émerge le neuf, et surtout ce qui est en mouvement.
C’est à partir de ces lieux d’intersection, mais aussi de frictions, voire de collisions que se tissent les nouveaux assemblages et qu’opèrent les nouvelles circulations. C’est là que s’invente une nouvelle imagination sociale, de nouvelles manières de se relier à soi et d’habiter le monde que l’on a qualifié d’afropolitaines. Et justement, qu’est-ce l’afropolitanisme sinon une pratique et une pensée de la circulation ? Et tout cela, vous le voyez, est à l’opposé des discours actuels sur l’autochtonie.
Car, ni l’indigénisme, ni le nativisme ne sauveront l’Afrique. Le Continent doit absolument s’ouvrir, et d’abord a lui-même. Que l’on abolisse les visas ; que l’on crée une vaste zone continentale de libre circulation ; que l’on accorde la nationalité africaine à qui veut l’obtenir. Puis, que l’on prépare le Continent a recevoir de nouvelles vagues de migrants. C’est notamment le cas des Chinois qui frappent a la porte ; des fermiers blancs sud-africains qui cherchent a s’installer au cœur du Continent ; des Portugais qui veulent revenir en Angola et au Mozambique ; des Indiens qui cherchent a établir de nouvelles colonies commerçantes partout ou on est prêt a les accueillir. Cette nouvelle ère de brassage et de métissage ouvrira la voie, j’en suis certain, à un autre possible historique et culturel.
Le continent est pris dans un débat relativement neuf sur l’homosexualité. Quelle est l’importance de l’organe male dans l’imagination sociale africaine ? En d’autres termes, quelle fonction porte le phallus en Afrique et comment envisage-t-on la vulve ?
Il faut éviter, certes, de tomber dans les clichés que dénonçait Frantz Fanon et qui ne voient en le Nègre qu’un membre. Ceci dit, dans les traditions africaines antiques, le phallus dans sa généralité est doté d’une singulière aura. Il est considéré comme le soleil de l’homme, son avoir magnifique, à la fois fouet et parure, jouet et bijou.
En même temps, le phallus brille par sa misère, voué qu’il est au crépuscule et à la détumescence. Voilà pourquoi il doit sans cesse exhiber les preuves de sa puissance et de sa vitalité. Mais au fond, sa puissance est fondamentalement profane et vaine puisqu’en vérité, le phallus est sans cesse menacé d’impuissance et de ce paradoxe, le roman africain postcolonial en témoigne à merveille.
La vulve, par contre, est un organe discret doté d’un extraordinaire pouvoir d’enchantement et, je dirais, d’ensorcèlement. Elle n’est montrée en public que dans des circonstances exceptionnelles, généralement comme un instrument de blasphème et de profanation du pouvoir. Porte d’entrée vers les sources ivres de la vie, elle est le sillon dans lequel la graine est enfouie, se meurt et renait. D’où son extraordinaire puissance et la menace potentielle qu’elle représente pour le principe masculin.
Telles étaient les choses dans le passe, et de tout cela, la sculpture africaine en particulier garde d’éminentes traces. Aujourd’hui, un autre ordre de la vie est en gestation.
À la loi du père (le colonisateur), vous semblez opposer la rivalité des frères. Pouvez-vous développer ce point ?
Pour être très précis, il faudrait plutôt parler de la « loi des vieillards » et, de façon subsidiaire, de celle des pères. Je crois qu’il est possible d’interpréter schématiquement une bonne partie des luttes sociales en cours en Afrique en termes d’opposition entre une classe de vieillards qui ne tiennent pas à mourir (ou en tous cas à mourir seuls) et une masse des cadets sociaux (les jeunes et les femmes) incapables de transformer radicalement leurs conditions de dépendance.
Les idéologies de l’ainesse ont été à l’origine de biens des désastres en Afrique. Et d’ailleurs elles sont inséparables des idéologies patriarcales. Un peuple dirigé par des vieillards n’est pas nécessairement un peuple sage. Souvent, il s’agit d’un peuple épuisée et dont l’imagination a, pour l’essentiel, tari. Il n’y a pas de relation automatique entre vieillesse et sagesse. Des vieillards qui dirigent l’Afrique, la plupart sont des figures funestes.
Pour le reste, j’évoque la « loi du père » dans le contexte des débats concernant la place de l’Occident dans le destin de l’Afrique. Des auteurs comme Valentin Mudimbe estiment qu’il est impossible pour les Africains de se débarrasser de ce qu’il appelle « l’odeur du père ». L’Occident, suggère-t-il, fait désormais partie intégrante de notre identité. Il est une part de nous-mêmes à un point tel que chercher à s’en séparer serait une forme d’automutilation.
En évoquant la rivalité des frères, j’essaie pour ma part de déplacer le débat en montrant qu’aujourd’hui, notre protagoniste principal n’est peut-être pas le père d’il n’y a pas longtemps – encore que de lui subsiste plus que l’odeur. Nous sommes peut-être devenus sinon nos propres ennemis, du moins notre propre différend. On ne pourra pas évacuer du revers de la main cette question de l’auto-inimitié si l’on veut aller de l’avant. Ceci suppose que nous ne nous racontions point d’histoires et que nous soyons comptables devant nous-mêmes – condition essentielle pour éventuellement demander des comptes au reste du monde.
Si – comme vous le dites dans votre dernier ouvrage Sortir de la grandenuit– l’homosexualité fait partie d’une stratification très profonde de l’inconscient sexuel des sociétés africaines, comment se vit-elle aujourd’hui et dans quelle mesure est-elle devenue un enjeu politique ?
Dans les sociétés africaines antiques, l’homosexualité remplissait trois types de fonctions. Et d’abord les fonctions initiatiques au sein des sociétés secrètes, des sociétés magiques et de certains cultes, à l’exemple justement des cultes du phallus qui étaient en réalité des rituels de célébration du principe vital ; ensuite des fonctions de « fraternisation » au sein des classes d’age ; et enfin des fonctions de libertinage.
On l’oublie trop souvent, il existe en Afrique de vieilles traditions de vie libertine, avec des jeux du sexe extrêmement sophistiqués, qui sont tout à fait libres des enjeux de reproduction.
Les civilisations traditionnelles ont développé, à l’égard du corps et du sexe, une étonnante liberté que la colonisation et le christianisme ont longtemps cherché à réprimer. Qu’il s’agisse des figures de la nudité, des jeux érotiques impliquant l’ensemble des cinq sens, des contes, des arts et de la sculpture, des danses, voire des conversations paillardes et des catégories générales de l’humour, les lieux de la sexualité étaient loin d’être des lieux traumatiques. La sexualité en tant que forme corporelle ou psychique du traumatisme est, chez nous, une invention du christianisme colonial.
Dans les métaphysiques anciennes, le corps en particulier était le siège de formes particulières du pouvoir, un lieu épiphanique. Et chaque organe du corps constituait, en soi, un gisement symbolique, le réceptacle de capacités figuratives propres. Quant aux sens, ils étaient considérés comme des réservoirs a mystères, autant de fenêtres sur le double du monde apparent. Toute éthique de la sexualité dans les conditions contemporaines doit partir de ce principe de liberté et de ce rapport joyeux avec le corps et les sens.
Pour le reste, les pratiques homosexuelles se sont répandues y compris là où la répression est avérée. Tout indique que ce processus est irréversible. Il est idiot de se prendre à rêver, au début de ce siècle, d’une Afrique sans homosexuels.
Faut-il s’inquiéter de ce que la lutte pour les droits LGBT soit en quelque sorte récupérée par l’Occident pour faire pression sur certains gouvernements africains et redouter en retour une instrumentalisation des droits LGBT par ceux-ci ?
A priori, je suis contre l’immixtion de l’Occident dans les affaires africaines – qu’il s’agisse des interventions militaires ou des pressions en vue d’adopter tel ou tel mode de vie ou telle ou telle forme de gouvernement sous le prétexte de l’universalité des valeurs. La vérité est que les Africains interviennent très peu dans les affaires des autres nations.
Les luttes des Africains – pour la démocratie, les droits des homosexuels, la liberté de circulation et ainsi de suite – doivent donc être menées par les Africains d’abord. C’est à eux de leur donner un contenu et c’est a eux seuls de dire le cours qu’ils souhaitent imprimer à leurs vies et à leur destin. Dans ce projet, ils sont d’abord comptables devant eux-mêmes. S’il y a un prix à payer, ils doivent le payer en premier. C’est à cette condition qu’ils seront maitres de leur destin, propriétaires d’eux-mêmes, créateurs et ayant-droits et non point des substituts de la cause des autres ou des pions dans des schémas qui les dépassent.
Ceci dit, il existe des formes de solidarité horizontales, voire planétaires, qu’il est utile de cultiver. Ces formes de solidarité passent par des relations d’Egalite. Mais la solidarité ne peut pas se substituer à la responsabilité première. Elle n’en est qu’un supplément. L’essentiel, c’est à nous de nous en occuper.
Comment analysez-vous le phénomène des migrations et notamment les migrations en direction d’une Europe fantasmée, et la position actuelle de l’Europe face à ces processus migratoires ?
L’Europe est saisie par un fort désir d’Apartheid. Partout, les murs sont reconstruits et les frontières militarisées. L’heure du grand partage entre ceux qui peuvent circuler librement a travers le monde et ceux qui doivent être confines chez eux ou qui ne peuvent bouger que sous certaines conditions rendues chaque jour plus draconiennes – cette heure est arrivée. Et la re-balkanisation du monde est en cours.
La plupart des pays européens rêvent désormais de refonder des communautés pures, sans étrangers. C’est qu’en plus de ne plus avoir grand-chose à dire au monde, ils ne veulent, en outre, ne rien apprendre du reste du monde. Il faut par conséquent laisser l’Europe à elle-même. Ma préoccupation, en tout cas, c’est d’abord l’Afrique au sein d’un monde dont l’Europe n’est plus le centre même si elle en demeure l’un des acteurs importants.
L’Afrique doit redevenir son centre propre, sa force propre.
Peut-être dois-je me répéter – pour y parvenir, elle doit abolir les frontières héritées de la colonisation, s’auto-constituer en tant que vaste espace de circulation, étendre la nationalité aux vieilles diasporas, encourager l’arrivée et l’implantation en Afrique de diasporas nouvelles et cesser de regarder vers l’Europe. C’est à cette condition qu’elle créera quelque chose d’éminemment neuf.
Achille Mbembe est professeur d’histoire et de sciences politiques a l’université du Witwatersrand (Johannesburg). Il est également le directeur du Johannesburg Workshop in Theory and Criticism (JWTC). Son dernier ouvrage, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, est paru aux Editions La Découverte en 2010.