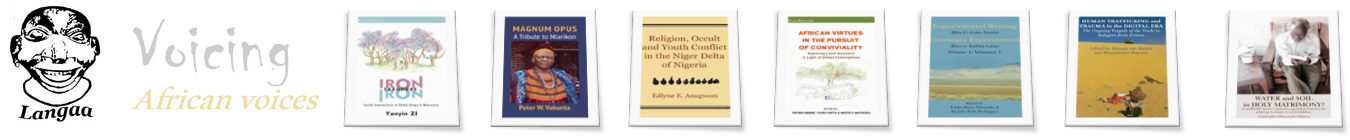Sabine Cessou | journaliste
Dans son dernier livre, le penseur camerounais décortique la face obscure de la pensée européenne : la transformation de personnes en objets, les « nègres ».
Achille Mbembe, 56 ans, historien et philosophe camerounais installé en Afrique du Sud, enseignant à Johannesburg et à Harvard (Etats-Unis), écrit régulièrement des essais percutants. L’avant-dernier, « Sortir de la grande nuit » (La Découverte, 2010), exhortait les citoyens africains à prendre leur destin démocratique en mains. Le dernier, « Critique de la raison nègre » (La Découverte, 2013), dégomme magistralement le racisme.
Cet essai renvoie par son titre au livre le plus connu de Kant, paru en 1781. Dans sa « Critique de la raison pure », le philosophe allemand exposait les limites de la rationalité. Achille Mbembe, lui, veut démolir la construction historique du nègre. Une invention européenne, dit-il, étroitement liée à l’essor du capitalisme, sur fond d’esclavage et de colonisation.
Avec la marginalisation de l’Europe dans l’économie mondiale et la montée en puissance des pays émergents, faut-il s’attendre à la fin du racisme post-colonial et à l’idée même de race nègre ? Ou faut-il au contraire s’attendre à d’autres modes d’exclusion, avec une nouvelle classe de déshérités dans l’économie-monde ? Ce sont deux des grandes questions que pose Mbembe. Entretien.
Rue89 : Vous dites dès le départ que l’Europe n’est plus le centre de gravité du monde, mais vous empruntez votre titre à Kant. Paradoxe ? Provocation ?
Achille Mbembe : Mon livre s’efforce de montrer que l’histoire de la raison dans notre modernité est tout sauf « pure ». Il faut prendre au sérieux sa part obscure, avec ce que le système capitaliste aura fait de l’humain. L’épreuve qu’aura été pour des millions de gens le fait d’avoir été transformés en objets et en marchandises. Le nègre en est la manifestation par excellence.
Voulez-vous tisser avec ce livre l’envers de la pensée européenne ?
Notre monde, pour être convenablement pensé, doit être considéré comme ayant un double. Ce livre s’efforce de lire le monde à partir de son envers ou de son double. Il n’y a pas de monde qui ne porte quelque part sa part d’ombre. La pensée dite européenne a souvent éprouvé beaucoup de difficulté à penser cette part obscure. C’est à son sujet que le livre s’efforce de dire une ou deux choses.
Vous parlez d’un éventuel « devenir-nègre » de l’humanité, avec une autre forme de ségrégation dans l’économie globale. Serait-ce une exclusion de race ou de classe ?
Elle mêle les deux. En fait, c’est l’un des arguments du livre : classe et race dans l’histoire de notre modernité et du capitalisme ont toujours été engendrées l’une par l’autre. Les Noirs ne sont pas les seules victimes d’un processus d’engendrement des races par la non exploitation d’une multitude de gens laissés à l’abandon. On pourrait dire que le racisme aujourd’hui est un racisme sans race.
Le sous-prolétaire chinois est-il un nouveau « nègre » ?
Oui, absolument. Les conditions d’exploitation du sous-prolétariat sont tout à fait extraordinaires en Chine. La mémoire du nègre, celui dont le travail est approprié en totalité, sans compensation, hante le présent capitaliste.
Nous n’avons plus beaucoup de formes de mobilisation politique, mais simplement de l’indignation… Est-ce suffisant ?
Ce n’est qu’un début. Le capitalisme est devenu abstrait pour beaucoup. Les forces primales du capitalisme sont devenues abstraites, anonymes, immatérielles. Leur vélocité est désormais numérique, elle n’est pas mesurable dans les normes temporelles classiques. Ce système est désormais sans visage, sans lieu et dépourvu de tout centre. Difficile donc d’imaginer comment l’abattre. Nous nous contentons d’une indignation morale. Or, ce système n’en a que faire ! La question reste entière, de savoir comment le réformer ou y mettre fin.
La pensée marxiste peut-elle encore servir ?
Il lui faut un énorme supplément pour qu’elle nous permette de saisir la complexité du système économique actuel. Ce supplément viendra-t-il ? Il faut qu’on y réfléchisse. Je m’inscris dans une tradition critique d’origine africaine, caribéenne, atlantique, américaine, mais aussi française et continentale. Ma réflexion se trouve également en dialogue avec la pensée critique de type marxiste – je préfèrerais dire « marxienne » – et notamment toute la pensée de gauche qui s’efforce de rendre compte des transformations du capitalisme à l’âge néolibéral.
Pourquoi dites-vous que le capitalisme s’apparente à de l’animisme ?
Pour deux raisons. La première, c’est que le processus de « civilisation » a consisté à distinguer les êtres humains des objets, à maintenir cette séparation. La barbarie, elle, confond l’être humain et la chose.
La seconde, c’est que la pulsion primaire du capitalisme a été d’effacer cette distinction : il transforme les hommes en choses, en marchandises, et octroie aux marchandises un statut de divinités. Le fait que les marchandises aient détrôné les divinités et soient devenues les destinataires de l’adoration des hommes, c’est pour moi « l’âge de convergence entre capitalisme et animisme ». Nous sommes en pleine idolâtrie. Tout est soluble dans tout.
Est-ce une forme de décadence ?
Cela permet une instabilité radicale, dans la mesure où tout devient possible pour les hommes, y compris signer leur propre fin – par la pollution, par exemple. Nous ne sommes pas dans la décadence, mais quelque chose de plus décisif. Il n’y a pas de limite. On peut consommer la nature entièrement. Se traiter les uns les autres comme on veut. La démocratie devient une voyoucratie comme on le voit dans plusieurs pays. La seule chose qui compte, c’est la capacité des uns et des autres à atteindre leur but. Les moyens ne comptent plus.
Vous répétez à chaque chapitre de votre livre « l’homme-métal, l’homme-monnaie » pour parler de l’esclave noir. Le traumatisme laissé par la traite est-il largement sous-estimé ?
Disons plutôt qu’il n’a pas fait l’objet d’une réflexion fondamentale. Il existe pourtant assez de matériaux pour engager cette réflexion et en saisir la portée pour aujourd’hui. Ces évènements historiques nous en disent long sur la capacité à faire l’histoire, y compris de la part des victimes de cette histoire.
Pas question d’une histoire des vainqueurs, donc ?
Tout histoire des vainqueurs appelle par définition sa contestation. Aucune histoire n’est d’ailleurs définitive.
Vous parlez du racisme comme d’une « folie », un « délire », une « névrose ». Vous rangez le racisme ordinaire, enraciné, parmi les pathologies mentales. En avez-vous discuté avec des psychiatres ?
Non, je n’ai pas essayé d’échanger avec les psychiatres, mais prolongé une tradition psychiatrique dont Frantz Fanon a été un protagoniste. Il a montré que le racisme a une dimension sociale et politique, mais aussi une part qui relève des troubles mentaux. Tout raciste est quelque part un fou qui s’ignore. Tout racisme a une dimension hallucinatoire, paranoïaque et phobique. Tout cela représente la figure d’un moi qui défaille. Un moi fêlé. Une part des discours sur les étrangers, sur l’islam, sur le voile n’a rien à voir avec la raison.
Par exemple, la ministre Christiane Taubira qui se fait traiter de « singe » ?
Oui, tout cela en fait partie. L’époque semble marquée par la libération de pulsions que la société n’arrive plus du tout à canaliser, et cherche encore moins à réprimer. Il fait bon, aujourd’hui, de défaillir. C’est bien plus grave que le populisme. Des processus de l’inconscient passent maintenant dans le discours public, sans même chercher à dompter comme autrefois la verdeur du racisme.
Aujourd’hui, on est fier d’être raciste, tout en niant qu’on l’est. Du coup, tous les antiracistes sont accusés de faire dans le bon sentiment, la générosité, la solidarité. L’accueil de l’étranger, du réfugié se trouve relégué dans l’ordre sentimentalisme. Comme si ceux qui défendent ces valeurs étaient des niais. Des naïfs qui ne comprennent pas que les vraies victimes sont les autochtones, qu’il faudrait protéger contre la menace allogène.
Est-ce un mal européen ?
Non, c’est à l’œuvre partout ! Même aux Etats-Unis, le pays par excellence où presque tout le monde vient d’ailleurs. Les derniers arrivés se montrent les plus pervers dans la dissémination de l’idéologie de l’autochtonie, comme s’ils voulaient fermer la porte à ceux qui viennent derrière eux. Voyez Sarkozy et Valls en France… C’est la même affaire ! Il faut les entendre, comme s’ils avaient été la depuis le paléolithique…
Vous dites que l’Africain-Américain est le « revenant de la modernité ». C’est-à-dire ?
Il aura vécu dans les soutes de la modernité. Les Africains-Américains auraient pu être exterminés, pendant la longue période de l’esclavage, à peu près quatre siècles. Ils ont survécu, fondé des communautés, créé des religions, ont été créateurs de culture et sont revenus de ces soutes vivants. Ils auront fait dans leur chair et dans leur âme l’expérience de ce que cela veut dire, vivre de l’autre côté de la vie. Voilà pourquoi ils sont des revenants de la modernité. Du coup, ils sont capables de porter sur elle un regard d’outre-tombe. Le livre s’efforce de comprendre la nature de cette expérience. Le chapitre intitulé « Requiem pour l’esclave » cherche à raconter cette expérience. Et à la chanter.
Les relations inter-raciales ont-elles évolué aux Etats-Unis depuis Obama ? Sont-elles un autre baromètre de l’évolution possible du monde ?
Elles restent très compliquées… Chaque progrès dans l’intégration des Noirs dans la fabrique de la nation s’est soldé par une réaction, une contre-révolution. La guerre d’indépendance, la guerre civile et la reconstruction ont été des catastrophes pour les droits des Noirs, et ont débouché sur la ségrégation. On a observé les mêmes retour de bâton, après les progrès en matière de droits civiques dans les années 60. L’élection d’Obama a rouvert la vanne raciste, du moins dans certaines parties des Etats-Unis.
Pour l’avenir, il est clair que ceux qu’on appelle « les Blancs » vont constituer une minorité d’ici une cinquantaine d’années. D’ores et déjà, leur pourcentage au sein de l’électorat américain va décroissant. A moyen terme, le pays sera encore plus cette énorme mosaïque humaine où les gens d’origine européenne constitueront une composante parmi les autres. D’énormes résistances se manifestent face à ce déclin annoncé.
Une nouvelle forme de racisme est d’ailleurs apparue : l’islamophobie. La question de la différence et de l’en-commun est vraiment la question fondamentale de notre temps, et pas seulement en Europe.
Vous travaillez sur un concept nouveau, que vous dénommez « afropolitanisme » ? S’agit-il, après la négritude et le panafricanisme, d’une nouvelle identité noire ?
C’est une tentative d’imaginer une identité africaine qui ne serait pas réductible à la couleur de la peau de qui que ce soit. C’est une identité au delà de la couleur et de la géographie, dans la mesure où beaucoup d’Africains ne vivent pas en Afrique, et dans la mesure où tous ceux qui vivent en Afrique ne sont pas non plus forcément des Africains. Il s’agit d’une identité qui cherche à embrasser le monde et non à se constituer comme une humanité à part.
Qui pourrait incarner l’Afropolitain ? Vous-même, en êtes vous un ?
Les incarnations les plus vivantes de l’afropolitanisme sont les migrants africains que l’on trouve dans une ville comme Johannesburg. Ces gens sont partis de chez eux et ont affronté l’inconnu, en faisant l’expérience du lointain et de la longue distance. L’afropolitanisme se construit au détour de ces pratiques de la circulation, qui sont comme le sous-sol culturel des sociétés africaines.
Cette pratique de la circulation se retrouve au niveau des élites comme au niveau populaire. Pour ouvrir l’avenir du continent et éviter des drames comme celui de Lampedusa, il faut sortir de l’enfermement. On ne peut pas fermer les portes de l’Europe et fermer l’Afrique de l’intérieur. Il faut mettre fin à ce double enfermement et faire du continent un vaste espace de circulation. Il est énorme, notre continent ! Il est sous-peuplé ! Il faut l’ouvrir pour que les gens puissent circuler et faire leur vie sans être contraints à l’exil.
Le continent va devenir ce vaste espace de circulation, mais aussi la destination de nouvelles migrations en provenance de la Chine, des vieux pays colonisateurs, des vieilles diasporas caribéennes qui veulent revenir.
Pas de nostalgie dans votre propos, pas de vieux rêve déçu de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ?
Non, pas du tout. L’OUA a au contraire légitimé les frontières et cherché à les rendre intangibles. L’afropolitanisme s’attaque à l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, pour sortir de ce que j’appelle « l’auto-incarcération ».
Pourtant, des sentiments nationaux existent en Afrique. Quand le Cameroun gagne une coupe de football, tout le pays et sa diaspora sont debout…
Oui, et quand le Cameroun atteint le quart de finale de la Coupe du monde, ce sont tous les Africains qui se lèvent ! Ce n’est pas incompatible, au contraire. D’autres formes d’assemblage à la mosaïque des identités sont possibles. Au fond, c’est à imaginer tout cela que l’époque nous appelle.
See online: Achille Mbembe : « Le sous-prolétaire chinois est un nouveau nègre