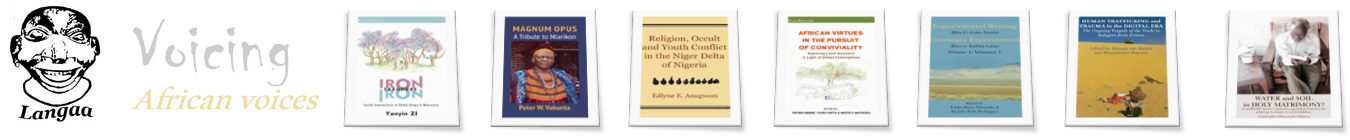Le Sénégal, à l’instar de nombreux autres pays de son espace régional, reste fortement marqué des contraintes et pesanteurs d’un substrat socio anthropologique où l’inégalité des sexes est érigée en norme. Cette situation se traduit, concrètement, par la pratique voire la recrudescence de certains types de violences sexuelles à savoir le viol et l’inceste. Les effets induits de telles violences se font principalement ressentir par la vulnérabilité des filles et des femmes qui en sont très majoritairement les principales cibles et victimes ; puis, par la pratique répandue de l’interruption volontaire de grossesse par ailleurs pénalement réprimée, l’accès à l’avortement médicalisé en pareilles circonstances n’étant pas encore autorisé.
Quelles sont les causes déterminantes de cette situation, quelles en sont les manifestations concrètes et quels voies et moyens sont à l’œuvre, pour y remédier ?
Voilà les interrogations qui guideront notre réflexion, dont le développement prendra en compte deux points essentiels : la problématique de santé publique que constitue la systématisation de l’interruption volontaire de grossesse dans les couches les plus défavorisées de la société sénégalaise ; l’exigence de responsabilisation des filles et des femmes, que suscite une situation dont la gravité concerne la société entière.
L’avortement à risque : un défi de santé publique au Sénégal
L’examen attentif d’un certain nombre d’informations collectées sur le terrain, révèle que la pratique de l’interruption volontaire au Sénégal est indissociable de la condition sociale et du statut des filles et des femmes.
L’organisation de la société sénégalaise demeure extrêmement patriarcale. Les filles et les femmes sont donc, très souvent, victimes de violences basées sur le genre.
Elles vivent par ailleurs dans une grande précarité, qui se manifeste notamment par leur grande fragilité économique et familiale. Ce qui accroit, considérablement, la vulnérabilité dont elles sont l’objet, et qui les expose d’autant plus aux cas spécifiques d’exploitation et violences sexuelles (inceste et viol).
L’avortement devient ainsi le moyen auquel elles ont le plus recours par défaut, par crainte de la double sanction de la stigmatisation de leurs propres familles et des communautés auxquelles elles appartiennent. Leur pauvreté économique les conduit également à faire appel à un « personnel sanitaire » non qualifié, dans le cas où elles ne s’autoadministrent pas elles-mêmes des substances supposées interrompre leur grossesse, mais qui leur sont cependant nuisibles.
Les conséquences qui découlent de ces avortements pratiqués dans la clandestinité et dans un environnement non médicalisé sont énormes. Elles sont à situer dans toute la chaîne des grandes pathologies auxquelles la politique de santé nationale est confrontée.
Elles convoquent une prise en charge globale des pouvoirs publics, en termes d’éducation et de prévention, de formation, de soins adaptés et de suivi.
L’une des stratégies de réponse des pouvoirs publics a bien été, à cet effet, la création d’une « Direction de la Santé de la Mère et de la Survie de l’Enfant » au Ministère de la santé.
Cette Direction a effectué plusieurs actions jugées efficaces, visant notamment à réduire les grossesses non désirées et à améliorer la prise en charge des avortements à risque (on peut citer, par exemple, l’introduction et la pratique des Soins Après-Avortements intégrés-SAA).
Ce qui illustre bien l’importance des coûts générés par les avortements à risque au Sénégal compte tenu de leur ampleur : le Guttmacher Institue recense ainsi dans son rapport d’avril 2015, plus de 51 500 avortements qui auraient été provoqués en 2012 au Sénégal, soit un taux de 17 avortements pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans…
Il va donc sans dire, que ce phénomène reste l’une des principales causes de mortalité maternelle, quand bien même le Sénégal peut être considéré comme un exemple en Afrique de l’Ouest, dans la lutte contre l’avortement à risque.
Quant à la législation sénégalaise en la matière, elle est des plus ambiguës.
Une incohérence peut être soulignée en effet, dans les dispositions du Code pénal criminalisant expressément l’avortement à risque en son article 305 (https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Senegal.abo.html)t et ce, même en cas de viol et/ou d’inceste.
Cet ordonnancement discriminatoire, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive accroît fortement le taux d’infanticide qui est l’une des principales causes d’incarcération des femmes au Sénégal (16%), comme en a fait état le rapport sur « La situation des droits des femmes dans les lieux de détention au Sénégal » du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) en Mars 2015.
Sous un tout autre registre, le protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique dit « Protocole de Maputo » qui en la matière fait office de législation régionale, dûment ratifié par le Sénégal, prévoit notamment en son article 14 l’avortement en cas de viol et d’inceste, dans le cadre de la promotion et de la protection du droit à la santé de la reproduction.
Ce défaut d’harmonisation de la législation nationale avec la législation régionale produit un impact assez important sur la condition des filles et des femmes, dont la prise en main des responsabilités n’en devient que plus urgente.
La responsabilité des femmes en question
Dans son Rapport annuel sur la Population du Sénégal en 2017, l’Agence Nationale de Statistiques et de Développement estime la proportion des femmes à 50,2% de la population nationale, contre 49,8% d’hommes.
Il n’en demeure pas moins que cette majorité -toute relative- de la population sénégalaise n’est pas logée à la même enseigne que les hommes. Le niveau de représentation dans les différents segments de la société sénégalaise en est une des manifestations concrètes. Les femmes ne s’engagent pas moins, pour autant, à réfléchir sur l’amélioration de leur statut, par la transformation du rapport de force qui leur est encore défavorable.
Ce réveil et ce sursaut sont largement tributaires du rapport de force que nous avons évoqué préalablement. Ils sont laborieux, les filles et les femmes s’appropriant assez faiblement la responsabilité des problèmes les concernant spécifiquement.
Il en est ainsi du plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste dont nous parlons : les femmes sont, en effet, les premières à rejeter cette approche. Et pour cause. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation paradoxale.
Il y a, en premier lieu, le faible niveau d’alphabétisation des femmes, auquel vient s’ajouter, conséquemment, l’inégal accès aux pôles de décision dont nous avons parlé, dans la fracture sociale dont elles sont les premières victimes, la société sénégalaise étant traversée d’antiques et différents courants de discriminations sexistes.
Néanmoins, depuis quelques années, dans un contexte mondial de développement inclusif et participatif, on note au sein de la couche féminine, un segment significatif qui essaie tant bien que mal d’occuper une place non négligeable dans la société. Le mode opératoire par essence, s’articule autour d’un maillage associatif lent et irréversible, et par un engagement au sein des Organisations de la Société Civile (OSC).
Dans ces instances d’information, de sensibilisation et de formation, les femmes s’activent pour lutter contre les discriminations dont elles font l’objet en société, et pour l’amélioration de leurs conditions de vie. A titre illustratif, on peut citer des associations de femmes qui militent pour le droit à la santé de la reproduction à travers l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste : il en est ainsi de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) et du Réseau Siggil Jigeen (RSJ)…
A l’élitisme des conditions d’admission à l’AJS, créée en 1974, on peut opposer son occupation des espaces communautaires de base. Ses « Boutiques de droit » sont, effectivement, des maillons essentiels d’une collecte d’information de proximité, d’information et d’accompagnement, dans toutes les démarches conduisant, progressivement, à l’affranchissement de justiciables en proie à la loi d’airain des violences relatives au genre.
Quant au Réseau Siggil Jigeen, il est une Organisation Non-Gouvernementale dont la création remonte à 1995, et qui revendique 16 organisations membres, visant 12 000 femmes à travers l’étendue du territoire national. Sa vocation première est de « contribuer à l’amélioration et au renforcement du statut de la femme sénégalaise ».
Le RJS a un champ d’activités centré autour de quatre points : la promotion de la mise en œuvre de stratégies efficaces de plaidoyer et de lobbyisme en faveur de la position de la femme ; le renforcement des capacités organisationnelles et d’intervention du réseau (RJS), de ses membres et des organisations des femmes ; la promotion des synergies entre le RJS, ses membres, les femmes et les différentes OSC ; la création et l’animation d’un espace de communication, de concertation et de documentation.
Les problèmes des femmes sont, d’une manière générale, les problèmes de toute la société.
La capacité de la société globale à se réapproprier les contraintes structurelles auxquelles sont confrontées les femmes est un indicateur de pertinence des projections de celle-ci.
Les deux cas de figure dont nous venons de faire cas ne sont pas les seuls à rendre compte des efforts consentis, douloureusement, par les filles et les femmes du Sénégal, pour briser les barrières de l’ignorance et de l’assujettissement dont elles sont les principales victimes.
L’engagement des femmes en politique constituerait bien aussi une lunette d’appréciation de leur statut, de leur rôle et de leur influence dans les débats de fond structurant leur présent et leur avenir. C’est-à-dire le présent et l’avenir de toute la société sénégalaise.
On pourrait bien se demander ainsi, quelle est leur seuil de représentativité aux différents conseils municipaux, à l’assemblé nationale ainsi qu’au sein des autres institutions de souveraineté consultatives ou décisionnelles.
La dimension sous-régionale des combats que mènent les femmes sénégalaises serait aussi à prendre en compte, dans les thèmes de réflexion à aborder prochainement : les dynamiques d’information et de mobilisation bénéficient aujourd’hui d’outils (technologiques) performants, qui transforment le rapport à l’espace (les frontières physiques) et à l’altérité.
Nous n’épuiserons donc pas ici, le thème de la responsabilité de la femme dans les enjeux de société qui la concernent au premier chef, en particulier l’avortement médicalisé en cas de viol ou d’inceste.
Les femmes ne mènent pas un combat exclusif pour leur liberté et pour leur responsabilité.
Leur approche est, « naturellement », inclusive de tous les autres acteurs sociaux, les hommes en premier. Les femmes portent la vie, elles transmettent, au quotidien, les fondamentaux de l’éducation que la société dans son ensemble assigne à tous ses membres.
Il serait illusoire et manifestement contre-productif, pour les hommes, acteurs prédominants – pour le moment du moins- de cette transaction sociale de fond, d’en faire fi. Il y va de leur propre équilibre et de celui de la société entière, qu’une contribution plus active et effective des filles et des femmes du Sénégal soit prise en compte, pour l’émergence d’un Sénégal réconcilié avec la moitié de lui-même dont il ne pourrait se défaire.
*Fatou Bintou MBAYE, Juriste et Politiste
Expert en WBG
Membre de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS)